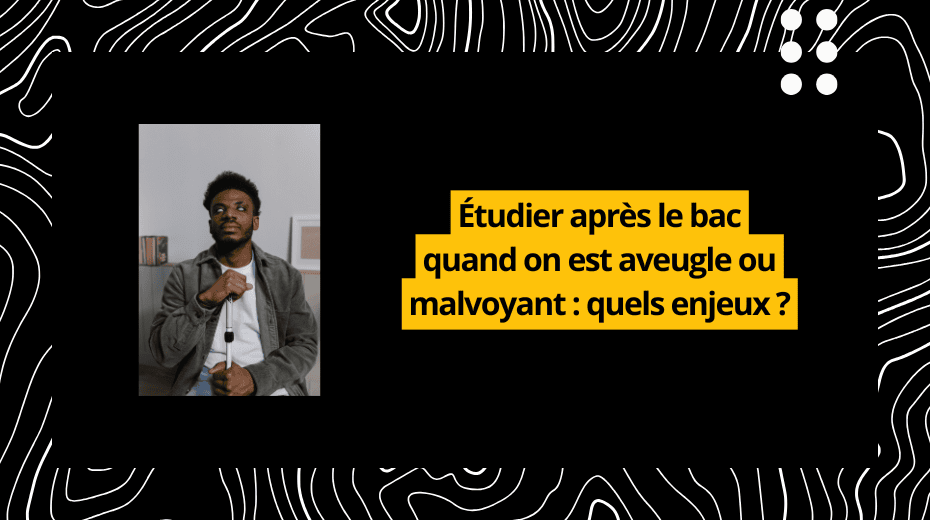Étudier après le bac quand on est aveugle ou malvoyant : quels enjeux ?
Bruno Gendron, Président de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, rappelle que tout le parcours étudiant doit être pensé à travers le prisme de l’accessibilité universelle et de l’approche par les droits : inscription sur Parcoursup, suivi des cours aux contenus de plus en plus visuels, accès à la documentation en bibliothèque, stages, alternance, mobilité internationale, examens… mais aussi sport, culture et vie associative.
Après la rentrée des classes, qu’en est-il de l’accès aux études post-bac pour les jeunes aveugles et malvoyants (qui représentent près de 5% des étudiants en situation de handicap, donc environ 3000 personnes) ?
Pouvoir suivre une formation post bac est d’abord une question de citoyenneté car comme tout un chacun, il en va de la liberté d’étudier, de l’égalité des étudiants déficients visuels ou non et in fine de la possibilité qui leur est offerte après leurs études, de pouvoir prétendre à une insertion professionnelle réussie et correspondant à leurs choix.
Pour ce faire, quels sont les enjeux spécifiques pour les étudiants aveugles et malvoyants ?
Pour les personnes déficientes visuelles, il s’agit de penser l’ensemble du parcours étudiant dans toutes ses dimensions et par le prisme de l’accessibilité universelle et de l’approche par les droits : pouvoir choisir son cursus, pouvoir s’inscrire sur parcours sup, pouvoir suivre les cours qui ont désormais un contenu visuel important (avec des aménagements et adaptations si nécessaire), pouvoir se documenter en bibliothèque, passer les examens, partir en stage ou en alternance, bénéficier d’une mobilité internationale, mais aussi avoir accès à tous les aspects de la vie étudiante (sport, vie culturelle et sociale, vie associative, etc.)
Quelles sont les difficultés spécifiques remontées par les associations membres de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, et les solutions ?
Tout d’abord, les lieux d’études sont trop souvent inaccessibles tant sur la partie bâtimentaire que numérique (difficulté d’accès aux documents écrits malgré leur numérisation, plateformes ou outils numériques inaccessibles).
On relève aussi que si tous les jeunes qui quittent le domicile familial font un saut dans l’inconnu, viennent s’ajouter pour les jeunes déficients visuels des aspects plus spécifiques. Ils connaissent parfois une rupture brutale des accompagnements médico-sociaux alors que leur autonomie est parfois encore insuffisante. Comme celle des autres jeunes de leur âge mais avec des obstacles supplémentaires !
Le repérage des lieux d’études, mais aussi des moyens de transports et des lieux de vie, avec l’appui de professionnels, est une illustration de ce qui pourrait être mis en place pour favoriser l’autonomie en toute confiance et plus tard, une insertion socioprofessionnelle réussie. A condition bien évidemment qu’un préalable soit rempli, celui de l’accessibilité universelle.